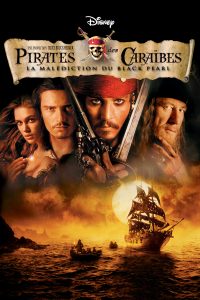 Les enfants du siècle.
Les enfants du siècle.
Et puis voilà que j’ai appris, en lisant la chose ici et là, que le film est la translation cinématographique d’une attraction créée à Disneyland, qui a dû faire briller bien des yeux de bambins et inspirer bien des vocations corsaires et boucanières ! Tout s’explique alors : on comprend mieux le manque d’épaisseur des personnages, l’indigence des dialogues, les bizarreries de l’intrigue – qui se veut à la fois sombre et rigolote -, l’infantilisme des situations, l’abondance des effets spéciaux et le parti pris d’en fourrer à tout moment pour tous les yeux. Youpi ! La belle après-midi !
 Le film de pirates bénéficiait jadis d’une riche tradition, généralement hollywoodienne, illuminée par les grands titres, Capitaine Blood (1935) avec le bondissant Errol Flynn, Le corsaire rouge (1952) avec le musculeux Burt Lancaster, Les Boucaniers (1958) avec le (pour une fois) chevelu Yul Brynner et même Pirates (1986) avec l’éructant Walter Matthau. Mais il s’était un peu endormi alors que la sauvagerie des mœurs de mer, l’exotisme des contrées parcourues par les spectaculaires trois-mâts, les grandes bouffées d’aventures ponctuées d’abordages au sabre et de rapts brutaux d’héroïnes à la fois craintives, frémissantes et émerveillées, ne pouvaient que fonctionner et ravir les générations de spectateurs.
Le film de pirates bénéficiait jadis d’une riche tradition, généralement hollywoodienne, illuminée par les grands titres, Capitaine Blood (1935) avec le bondissant Errol Flynn, Le corsaire rouge (1952) avec le musculeux Burt Lancaster, Les Boucaniers (1958) avec le (pour une fois) chevelu Yul Brynner et même Pirates (1986) avec l’éructant Walter Matthau. Mais il s’était un peu endormi alors que la sauvagerie des mœurs de mer, l’exotisme des contrées parcourues par les spectaculaires trois-mâts, les grandes bouffées d’aventures ponctuées d’abordages au sabre et de rapts brutaux d’héroïnes à la fois craintives, frémissantes et émerveillées, ne pouvaient que fonctionner et ravir les générations de spectateurs.
 Pirates des Caraïbes date, hélas, de 2003, c’est-à-dire d’une période où le cinéma commence à laisser la place au pur spectacle, nourri d’effets spéciaux rendus de plus en plus ahurissants par l’invasion numérique. Ce qui compte, ce n’est plus l’aventure, le mystère, l’héroïsme, la beauté des paysages, c’est l’effet, la brusque accentuation du niveau d’adrénaline suscitée par des images brutales et confondantes.Mettons au crédit du film de Gore Verbinski quelques agréables trouvailles, par exemple la transformation en squelettes des bandits qui subissent la malédiction du vaisseau Black Pearl dès que la lune surgit, quelques images sympathiques comme celle des condamnés pendus et desséchés à l’entrée du port, de l’ingéniosité scénaristique dans plusieurs séquences, comme celle où Jack Sparrow (Johnny Depp) et Will Turner (Orlando Bloom) se battent en duel dans une armurerie poussiéreuse et rivalisent d’habileté et d’élégance.
Pirates des Caraïbes date, hélas, de 2003, c’est-à-dire d’une période où le cinéma commence à laisser la place au pur spectacle, nourri d’effets spéciaux rendus de plus en plus ahurissants par l’invasion numérique. Ce qui compte, ce n’est plus l’aventure, le mystère, l’héroïsme, la beauté des paysages, c’est l’effet, la brusque accentuation du niveau d’adrénaline suscitée par des images brutales et confondantes.Mettons au crédit du film de Gore Verbinski quelques agréables trouvailles, par exemple la transformation en squelettes des bandits qui subissent la malédiction du vaisseau Black Pearl dès que la lune surgit, quelques images sympathiques comme celle des condamnés pendus et desséchés à l’entrée du port, de l’ingéniosité scénaristique dans plusieurs séquences, comme celle où Jack Sparrow (Johnny Depp) et Will Turner (Orlando Bloom) se battent en duel dans une armurerie poussiéreuse et rivalisent d’habileté et d’élégance.
 Mais l’humour revendiqué est essentiellement potache, fabriqué à coup de recettes éprouvées qui devaient, au moment de la sortie du film faire chavirer des régiments de péronnelles partagées en deux camps irréconciliables : les amoureuses de Depp et celles de Bloom.Et puis c’est long, mais long ! 2h20 répétitives où les gentils et les méchants ne cessent de prendre le pas les uns sur les autres, de s’emparer de leurs bateaux alternativement, ce qui fait qu’on n’est plus certain, à divers moments de savoir où on en est.
Mais l’humour revendiqué est essentiellement potache, fabriqué à coup de recettes éprouvées qui devaient, au moment de la sortie du film faire chavirer des régiments de péronnelles partagées en deux camps irréconciliables : les amoureuses de Depp et celles de Bloom.Et puis c’est long, mais long ! 2h20 répétitives où les gentils et les méchants ne cessent de prendre le pas les uns sur les autres, de s’emparer de leurs bateaux alternativement, ce qui fait qu’on n’est plus certain, à divers moments de savoir où on en est.Gentil divertissement pour adolescents qui a tout de même donné lieu à quatre suites, paraît-il plus invraisemblables et relâchées les unes que les autres. Qu’est-ce que le cinéma a à voir là-dedans ?