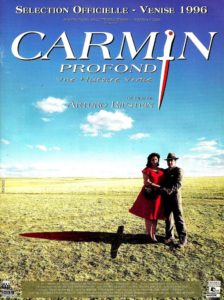La sanglante chevauchée de Raymond Fernandez et de Martha Beck, surnommés Les tueurs aux petites annonces – puisque c’est ainsi qu’ils sélectionnaient leurs victimes – s’est achevée par leur exécution en 1951. En 1948 et 1949, ils ont fait passer de vie à trépas une bonne vingtaine de femmes esseulées afin de les dépouiller de leur argent et de leurs biens. En lisant aujourd’hui dans les gazettes les mésaventures de braves personnes en quête d’amour qui se font rouler par des brouteurs sénégalais en étant persuadées qu’elles entretiennent une correspondance amoureuse avec une star de cinéma, on se rappelle, s’il en était besoin, que le monde n’est pas prêt de changer. Sauf en pire, il est vrai.
 L’histoire, à la fois rocambolesque et sanglante, a inspiré plusieurs adaptations, au cinéma ou à la télévision ; la plus notoire est Les tueurs de la lune de miel de Leonard Kastle (1970), film glauque, malsain, puissant, sec, sans empathie aucune. Carmin profond (quel beau titre !) a été réalisé en 1996 par Arturo Ripstein, réalisateur mexicain dont Wikipédia m’indique qu’il est réputé pour son cinéma sombre, lent, cruel et désespéré mais dont l’aura doit être limité à son pays d’origine et à l’Amérique latine.
L’histoire, à la fois rocambolesque et sanglante, a inspiré plusieurs adaptations, au cinéma ou à la télévision ; la plus notoire est Les tueurs de la lune de miel de Leonard Kastle (1970), film glauque, malsain, puissant, sec, sans empathie aucune. Carmin profond (quel beau titre !) a été réalisé en 1996 par Arturo Ripstein, réalisateur mexicain dont Wikipédia m’indique qu’il est réputé pour son cinéma sombre, lent, cruel et désespéré mais dont l’aura doit être limité à son pays d’origine et à l’Amérique latine.
J’étais curieux de découvrir comment ce sujet formidable pouvait être traité par un cinéaste mexicain. D’abord parce que l’on sait les rapports singuliers que les Mexicains, descendants des Aztèques, entretiennent avec la mort. Et puis la même dérive criminelle traitée de deux façons différentes, c’est toujours intéressant.
 Le film de Kastle a été tourné dans un beau Noir et Blanc ; celui de Ripstein en couleurs, en couleurs ternes, moches, salies ; ceci est loin d’être un reproche, bien au contraire. Montrer la vulgarité, la mesquinerie, la parcimonie de deux individus aussi fondamentalement minables l’un que l’autre et seulement rendus intéressants par l’étrange passion qui les unit est une réussite. Relation à base d’adulation charnelle de Coral (Regina Orozco) pour Nicolà (Daniel Giménez Cacho), du narcissisme de Nicolà (qui attache une importance passionnée à sa perruque), de relations sadomasochistes et à … une parfaite indifférence pour le reste de l’Humanité.
Le film de Kastle a été tourné dans un beau Noir et Blanc ; celui de Ripstein en couleurs, en couleurs ternes, moches, salies ; ceci est loin d’être un reproche, bien au contraire. Montrer la vulgarité, la mesquinerie, la parcimonie de deux individus aussi fondamentalement minables l’un que l’autre et seulement rendus intéressants par l’étrange passion qui les unit est une réussite. Relation à base d’adulation charnelle de Coral (Regina Orozco) pour Nicolà (Daniel Giménez Cacho), du narcissisme de Nicolà (qui attache une importance passionnée à sa perruque), de relations sadomasochistes et à … une parfaite indifférence pour le reste de l’Humanité.
 Pour suivre Nicolà sur les routes des chantages affectifs qu’il mène au gré des petites annonces où le couple repère des femmes seules, en recherche d’affection et possiblement dotées de bons revenus, Coral a abandonné ses deux filles à une institution religieuse et, si elle les regrette (comme on regretterait un colibri) n’envisage pas un instant d’aller les revoir, moins encore de les reprendre ; et lorsqu’il faut noyer la petite fille de Rebecca (Veronica Merchant), une jeune veuve charmante qui à Nicolà a fait un enfant – ce que Coral ne supporte pas – c’est qu’après que l’amant a tué la mère, il faut bien noyer la fille.
Pour suivre Nicolà sur les routes des chantages affectifs qu’il mène au gré des petites annonces où le couple repère des femmes seules, en recherche d’affection et possiblement dotées de bons revenus, Coral a abandonné ses deux filles à une institution religieuse et, si elle les regrette (comme on regretterait un colibri) n’envisage pas un instant d’aller les revoir, moins encore de les reprendre ; et lorsqu’il faut noyer la petite fille de Rebecca (Veronica Merchant), une jeune veuve charmante qui à Nicolà a fait un enfant – ce que Coral ne supporte pas – c’est qu’après que l’amant a tué la mère, il faut bien noyer la fille.
 Autre très grande réussite : la musique ! Parce qu’elle est presque toujours en complet décalage avec le rythme du récit et sa nature. Ainsi, lors de la première nuit entre les amants, Nicolà découche en volant le porte-monnaie de Coral, tout cela sur une mélodie douce, niaise, romanesque à la Richard Claydermann. Et à plusieurs reprises, dans les moments où les images sont pathétiques, accablantes, la musique déroule des volutes glorieuses ou bienveillantes.
Autre très grande réussite : la musique ! Parce qu’elle est presque toujours en complet décalage avec le rythme du récit et sa nature. Ainsi, lors de la première nuit entre les amants, Nicolà découche en volant le porte-monnaie de Coral, tout cela sur une mélodie douce, niaise, romanesque à la Richard Claydermann. Et à plusieurs reprises, dans les moments où les images sont pathétiques, accablantes, la musique déroule des volutes glorieuses ou bienveillantes.
Plus que dans Les tueurs de la lune de miel, les rencontres sont baroques, presque comiques ou ridicules, celle avec Irène (Marisa Paredes) particulièrement ; la violence est presque absente. Mais le malaise est bien là.