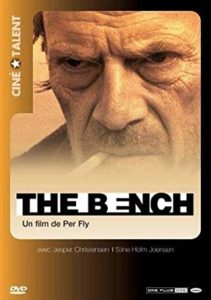 Seul contre tous.
Seul contre tous.
Il faut croire qu’il existe un cinéma danois, ce qui n’est pas donné à tout le monde et qui ne se limite pas à l’ancêtre Dreyer. À regarder d’un peu près il y a eu Bille August qui a obtenu deux Palmes d’or à Cannes (Pelle le conquérant et Les meilleures intentions) et surtout l’équipe du Dogme avec Thomas Vinterberg (Festen) et surtout Lars von Trier dont on ne peut pas ignorer Dancer in the dark, Antichrist et Melancholia. Et tout cela a éveillé de nouveau cinéastes, comme ce Per Fly qui s’est intéressé aux prescriptions strictes du Dogme, mais s’en est utilement débarrassé pour se plonger dans une sorte d’exploration sociologique de la société danoise.
 À dire vrai, à regarder The bench qui se passe on ne sait où au Danemark, on n’a pas vraiment envie d’aller cingler vers les pays scandinaves. Le ciel gris, le froid, le vent, bien sûr mais encore davantage la banalité accablante de villes qui ne semblent avoir d’autre rôle que d’abriter de pauvres gens. Là-dessus, remarquons bien, personne n’a grand chose à s’envier ; les cités minables, pelées, glaciales sont à peu près pareilles un peu partout, chez Ken Loach en Angleterre, chez Lucas Belvaux en Wallonie, chez Rudnicki en France. Mais j’ai l’impression en plus que, tout au Nord, on se bibinne, se biture, se saoule, s’anéantit, avec davantage de détermination.
À dire vrai, à regarder The bench qui se passe on ne sait où au Danemark, on n’a pas vraiment envie d’aller cingler vers les pays scandinaves. Le ciel gris, le froid, le vent, bien sûr mais encore davantage la banalité accablante de villes qui ne semblent avoir d’autre rôle que d’abriter de pauvres gens. Là-dessus, remarquons bien, personne n’a grand chose à s’envier ; les cités minables, pelées, glaciales sont à peu près pareilles un peu partout, chez Ken Loach en Angleterre, chez Lucas Belvaux en Wallonie, chez Rudnicki en France. Mais j’ai l’impression en plus que, tout au Nord, on se bibinne, se biture, se saoule, s’anéantit, avec davantage de détermination.
 Donc Kaj (Jesper Christensen, vraiment remarquable), qui jadis fut cuisinier dans une excellente maison et qui désormais survit dans de petits boulots grâce à un de ces programmes de réinsertion qui sont une des plus belles impostures du capitalisme vainqueur et triomphant (revoir La loi du marché de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon). Petit groupe de marginaux imbibés et fragiles qui se réunit frileusement au milieu de quelques bancs minables (d’où le titre du film). Aux côtés de Kaj, il y a Stig (Nicolaj Kopernikus) qui est un peu son homme lige, son complice, son garde du corps et aussi d’autres pauvres épaves qui survivent en éclusant des bières et en attendant, au bout du mois, les rassurantes allocations que l’État-providence alloue.
Donc Kaj (Jesper Christensen, vraiment remarquable), qui jadis fut cuisinier dans une excellente maison et qui désormais survit dans de petits boulots grâce à un de ces programmes de réinsertion qui sont une des plus belles impostures du capitalisme vainqueur et triomphant (revoir La loi du marché de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon). Petit groupe de marginaux imbibés et fragiles qui se réunit frileusement au milieu de quelques bancs minables (d’où le titre du film). Aux côtés de Kaj, il y a Stig (Nicolaj Kopernikus) qui est un peu son homme lige, son complice, son garde du corps et aussi d’autres pauvres épaves qui survivent en éclusant des bières et en attendant, au bout du mois, les rassurantes allocations que l’État-providence alloue.

Débarque un jour au milieu de cette géhenne une jeune femme, Liv (Stine Holm Joensen), flanquée de son petit garçon Jonas (Marius Sonne Janischefska). Liv fuit la violence de son mari Lars (Lars Brygmann), qui la tolchoque régulièrement en faisant des crises de jalousie. Jusque là, on est tout à fait dans l’épure et on se navre sans vraiment s’en étonner des malfaisances de notre pauvre humanité. Mais – c’est là que le film prend une voie un peu curieuse – il se trouve que Liv est la fille de Kaj qu’il a abandonnée 19 ans auparavant, parce qu’il ne s’est jamais senti la possibilité d’être père. Lui a immédiatement reconnu sa fille, elle n’a rien remarqué. D’autant que la pauvre malheureuse, qui a trouvé une sous-location chez Kim (Jens Albinus) un étudiant doctorant en philosophie, et qui n’est pas désagréable à regarder doit se débattre au milieu de entreprises de son mari Lars, qui veut la récupérer et les velléités de Kim qui en tombe amoureux.

Le film passe donc là complétement dans le registre du mélodrame. Par une suite de tours de passe-passe, Kaj et Stig commencent à s’occuper du jeune Jonas jusqu’à devenir indispensables… mais aussi jusqu’à ce que Kaj en vienne enfin à révéler à Liv qu’il est son père ; ce que la jeune femme, encore pleine de haine pour cet homme qui l’a abandonnée, n’accepte pas. Toute cette histoire-là n’a qu’un intérêt limité, moins fort en tout cas que la chute de plus en plus rapide de Kaj vers l’imbibation alcoolique ; il y a une scène assez glaçante et parfaitement filmée où Christensen ingurgite avec violence, avec une sorte de détermination suicidaire des litres d’aquavit, de gin, de whisky…
On imagine bien où tout cela doit s’achever. Et la fin évidente de Kaj ne résout rien. On songe au petit Jonas qui se bouche les oreilles et se raconte de jolies histoires lorsque son père frappe sa mère. Comment pourrait-il se sortir de ce monde crapoteux ?