J’irai bien moins loin dans l’enthousiasme que la plupart des admirateurs et ma note ne dépasse la moyenne que grâce à la luminosité extrême des lieux filmés – la grande demeure patricienne de Parme, les plages adriatiques immenses du côté de Rimini – et à la perfection de la beauté et du jeu des deux principaux protagonistes, Lorenzo (Jacques Perrin ) et Aïda (Claudia Cardinale
) et Aïda (Claudia Cardinale ).
).
C’est bien, c’est magnifiquement filmé (et, par ailleurs, présenté dans une édition impeccable), mais enfin, à mes yeux, ça n’accroche pas trop, infiniment moins, en tout cas que bien des films italiens tournés à peu près à la même époque, et notamment Le fanfaron , qui est aussi un récit de rencontre, mais moins romanesque, si l’on veut et moins rebattue.
, qui est aussi un récit de rencontre, mais moins romanesque, si l’on veut et moins rebattue.
 Car l’histoire de la pauvre fille qui fait presque commerce de son corps, tout en croyant qu’elle pourra un jour s’en sortir et du grand dadais assez contraint par sa condition sociale, mais dont la sensualité bourgeonne, cette histoire est tout de même d’une grande banalité… Lorenzo s’imagine, comme tous les puceaux émoustillés par une belle fille (et il faut admettre qu’Aïda est vraiment sublime) qu’il nourrit de beaux, amples, sublimes sentiments, alors même que c’est sa virilité qui bouillonne, et que se refuser le morceau de choix qui se donne est une occasion de se refuser, par la frustration, l’assouvissement, donc, d’une certaine façon, de la contenter en la sublimant. (Je sais, cela n’est pas clair, et il faut pour le comprendre, avoir connu la volupté extrême du refus chevaleresque : cela se passait il y a cinquante ans, dans les sociétés policées).
Car l’histoire de la pauvre fille qui fait presque commerce de son corps, tout en croyant qu’elle pourra un jour s’en sortir et du grand dadais assez contraint par sa condition sociale, mais dont la sensualité bourgeonne, cette histoire est tout de même d’une grande banalité… Lorenzo s’imagine, comme tous les puceaux émoustillés par une belle fille (et il faut admettre qu’Aïda est vraiment sublime) qu’il nourrit de beaux, amples, sublimes sentiments, alors même que c’est sa virilité qui bouillonne, et que se refuser le morceau de choix qui se donne est une occasion de se refuser, par la frustration, l’assouvissement, donc, d’une certaine façon, de la contenter en la sublimant. (Je sais, cela n’est pas clair, et il faut pour le comprendre, avoir connu la volupté extrême du refus chevaleresque : cela se passait il y a cinquante ans, dans les sociétés policées).
 Donc, puisqu’il ne peut y avoir d’amour, sauf pour la beauté du geste, entre cette pauvre fille déjà perdue, à la fois romantique et terriblement réaliste et ce grand garçon mauvais élève qui ne peut pas encore jeter sa gourme, qu’est-ce qui reste ? La supériorité sociale et son témoin le plus visible, l’argent… Les rapports entre Lorenzo et Aïda sont forcément de cette nature, quelles que soient les velléités et les fantasmagories que l’un et l’autre peuvent nourrir. Lorsque Aïda descend l’escalier, vivante incarnation de l’héroïne de Verdi
Donc, puisqu’il ne peut y avoir d’amour, sauf pour la beauté du geste, entre cette pauvre fille déjà perdue, à la fois romantique et terriblement réaliste et ce grand garçon mauvais élève qui ne peut pas encore jeter sa gourme, qu’est-ce qui reste ? La supériorité sociale et son témoin le plus visible, l’argent… Les rapports entre Lorenzo et Aïda sont forcément de cette nature, quelles que soient les velléités et les fantasmagories que l’un et l’autre peuvent nourrir. Lorsque Aïda descend l’escalier, vivante incarnation de l’héroïne de Verdi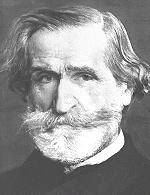 , il y a bien, à un moment, un bouleversement sensuel d’une acuité extrême ; mais arrivée au bout de son parcours, à quoi se bute-t-elle, sinon au désir évident, primaire, animal du jeune homme qu’elle ne peut, ni ne veut satisfaire parce qu’elle et lui ont voulu placer leur relation sur un autre niveau, celui d’un amour qui n’a absolument aucune chance d’exister vraiment, une fois les masques tombés.
, il y a bien, à un moment, un bouleversement sensuel d’une acuité extrême ; mais arrivée au bout de son parcours, à quoi se bute-t-elle, sinon au désir évident, primaire, animal du jeune homme qu’elle ne peut, ni ne veut satisfaire parce qu’elle et lui ont voulu placer leur relation sur un autre niveau, celui d’un amour qui n’a absolument aucune chance d’exister vraiment, une fois les masques tombés.
 Le sort d’Aïda est d’être une de ces bimbos qui dansent, à demi ivres sur les toits chaleureux des hôtels de luxe, en compagnie de mâles aussi veules que réels ; le sort de Lorenzo est de retourner sagement à Parme, et d’y vivre là un destin ni pire, ni meilleur que celui de ses pareils : il aura croisé, à un moment de sa vie, un autre monde et il se sera fait des souvenirs…
Le sort d’Aïda est d’être une de ces bimbos qui dansent, à demi ivres sur les toits chaleureux des hôtels de luxe, en compagnie de mâles aussi veules que réels ; le sort de Lorenzo est de retourner sagement à Parme, et d’y vivre là un destin ni pire, ni meilleur que celui de ses pareils : il aura croisé, à un moment de sa vie, un autre monde et il se sera fait des souvenirs…
Il me semble que tout cela est d’une grande banalité, si bien mis en scène que ce soit et que, finalement, il n’y ait ni drame, ni rédemption : chacun se retrouvera à sa place, la place donnée de toute éternité à l’un et à l’autre…
 Que Zurlini
Que Zurlini , marxiste d’élégance, comme l’était le chef du Parti communiste italien de l’époque, Enrico Berlinguer en tire des conclusions attristées, cela va bien, dans le climat idéologique de l’époque ; mais que Jean-Luc Douin et (pire encore !) Laure Adler tirent de ces enfantillages des leçons qui se veulent graves, dans les suppléments du DVD, est un peu navrant, parce que surjoué ; ils tireraient presque, si on les écoutait, cette excellente Fille à la valise
, marxiste d’élégance, comme l’était le chef du Parti communiste italien de l’époque, Enrico Berlinguer en tire des conclusions attristées, cela va bien, dans le climat idéologique de l’époque ; mais que Jean-Luc Douin et (pire encore !) Laure Adler tirent de ces enfantillages des leçons qui se veulent graves, dans les suppléments du DVD, est un peu navrant, parce que surjoué ; ils tireraient presque, si on les écoutait, cette excellente Fille à la valise vers les déroutants remugles de Mourir d’aimer
vers les déroutants remugles de Mourir d’aimer et des niaiseries compassionnelles y afférentes ; ça vaut infiniment mieux, mais ça ne brutalise jamais le cœur et l’âme..
et des niaiseries compassionnelles y afférentes ; ça vaut infiniment mieux, mais ça ne brutalise jamais le cœur et l’âme..
_______________________
Ah là là, moi qui vérifie d’habitude tout avec un soin qui confine à la maniaquerie, je suis bien contrit d’avoir écrit cette énormité d’un Berlinguer patron du PCI en 1961 (mais il était déjà Secrétaire du comité central en 1946 ; je bats ma coulpe, enfile ma chemise, me déchausse, couvre ma tête de cendres et tout le bataclan.
 Ce que je voulais dire, allant sans doute un peu au delà de la main, c’est que le récit, très classique ne pouvait précisément pas entrer dans les canons sacro-saints (à l’époque) du marxisme-léninisme ; et, d’ailleurs, je crains d’avoir été influencé en ce sens par les suppléments du DVD, notamment la préface de Jean-Luc Douin qui m’a appris ce marxisme de Zurlini
Ce que je voulais dire, allant sans doute un peu au delà de la main, c’est que le récit, très classique ne pouvait précisément pas entrer dans les canons sacro-saints (à l’époque) du marxisme-léninisme ; et, d’ailleurs, je crains d’avoir été influencé en ce sens par les suppléments du DVD, notamment la préface de Jean-Luc Douin qui m’a appris ce marxisme de Zurlini (faille assez partagée, entre 1945 et 1975 par l‘intelligentsia artistique européenne) et a sans doute biaisé mon appréciation.
(faille assez partagée, entre 1945 et 1975 par l‘intelligentsia artistique européenne) et a sans doute biaisé mon appréciation.
Mais j’en conviens très volontiers, La fille à la valise n’a rien de politique, sauf si on sur-interprète certaines séquences et certains personnages (ainsi Douin fustigeant l’hypocrisie du clergé, en évoquant le prêtre, professeur de mathématiques de Lorenzo et dépêché auprès de Aïda pour lui rappeler que le jeune homme a d’autres chats à fouetter que de s’amouracher d’une fille plus âgée, à la vie plus…légère : ce qui serait déjà normal en 2009 parait d’une telle évidence en 1961 !). Rien d’engagé, sauf à considérer, de façon étroitement naïve que, dans un monde idéal, les tourtereaux pourraient, nonobstant leurs différences, vivre quelques années d’amour et du revenu des propriétés de Lorenzo.
n’a rien de politique, sauf si on sur-interprète certaines séquences et certains personnages (ainsi Douin fustigeant l’hypocrisie du clergé, en évoquant le prêtre, professeur de mathématiques de Lorenzo et dépêché auprès de Aïda pour lui rappeler que le jeune homme a d’autres chats à fouetter que de s’amouracher d’une fille plus âgée, à la vie plus…légère : ce qui serait déjà normal en 2009 parait d’une telle évidence en 1961 !). Rien d’engagé, sauf à considérer, de façon étroitement naïve que, dans un monde idéal, les tourtereaux pourraient, nonobstant leurs différences, vivre quelques années d’amour et du revenu des propriétés de Lorenzo.
Il ne faut pas lire que je n’ai pas apprécié le film ; je redis que les acteurs sont merveilleux, les musiques parfaitement choisies, la photographie et la mise en scène excellentes. Peut-on admettre que ce que je juge être la niaiserie du sujet ne m’a pas accroché tout simplement ?
