Heureusement, ça s’est arrêté là ; car si après le très sympathique et réussi Nous irons à Paris et l’assez pesant Nous irons à Monte-Carlo
et l’assez pesant Nous irons à Monte-Carlo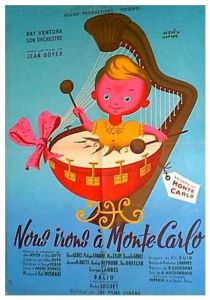 , il y avait eu un Nous irons à Pampérigouste, puis un Nous irons à Raddon-et-Chappendu, le chemin de croix eût été terrifiant.
, il y avait eu un Nous irons à Pampérigouste, puis un Nous irons à Raddon-et-Chappendu, le chemin de croix eût été terrifiant.
Après le beau succès de Nous irons à Paris , on tente donc la suite et on se dirige vers ce qui était déjà une principauté d’opérette, dont on rêvait sans jamais y être allé, ce Monte-Carlo voué aux acteurs américains, aux gens du monde et aux orchestres de variété (le dernier occupant des lieux fut le swinguant et ringardissime Aimé Barelli) ; ça a peine changé, mais désormais le populo peut, du fait de l’expansion de la bagnole et à l’élévation générale du niveau de vie venir voir de plus près comment se comportent ce qu’il appelle naïvement les people.
, on tente donc la suite et on se dirige vers ce qui était déjà une principauté d’opérette, dont on rêvait sans jamais y être allé, ce Monte-Carlo voué aux acteurs américains, aux gens du monde et aux orchestres de variété (le dernier occupant des lieux fut le swinguant et ringardissime Aimé Barelli) ; ça a peine changé, mais désormais le populo peut, du fait de l’expansion de la bagnole et à l’élévation générale du niveau de vie venir voir de plus près comment se comportent ce qu’il appelle naïvement les people.
 Car Nous irons à Monte-Carlo
Car Nous irons à Monte-Carlo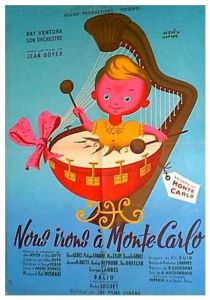 se déroule en 1952, époque antédiluvienne, sans doute, mais où existe éternellement, en grande majesté, l‘Hôtel de Paris où les musiciens de Ray Ventura vont venir prendre leurs quartiers, affublés d’un bébé rocambolesquement dérobé, ou plutôt disputé entre ses parents, au gré d’une intrigue presque compliquée et nullement convaincante.
se déroule en 1952, époque antédiluvienne, sans doute, mais où existe éternellement, en grande majesté, l‘Hôtel de Paris où les musiciens de Ray Ventura vont venir prendre leurs quartiers, affublés d’un bébé rocambolesquement dérobé, ou plutôt disputé entre ses parents, au gré d’une intrigue presque compliquée et nullement convaincante.
 La bêtise de l’anecdote n’a pas beaucoup d’importance ; en a un peu davantage ce monde construit avec plein de braves gens affairés et bienveillants ; la naïveté bon enfant, les amoureux qui se retrouvent, malgré les épreuves qui sont presque un exercice imposé de leur rencontre, les numéros musicaux qui interviennent à tout moment sont la loi du genre ; d’ailleurs les parties musicales de Nous irons à Monte-Carlo
La bêtise de l’anecdote n’a pas beaucoup d’importance ; en a un peu davantage ce monde construit avec plein de braves gens affairés et bienveillants ; la naïveté bon enfant, les amoureux qui se retrouvent, malgré les épreuves qui sont presque un exercice imposé de leur rencontre, les numéros musicaux qui interviennent à tout moment sont la loi du genre ; d’ailleurs les parties musicales de Nous irons à Monte-Carlo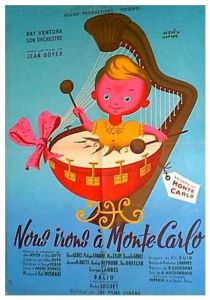 , dues à Paul Misraki
, dues à Paul Misraki , ne sont pas du tout désagréables, et les mélodies de Oui, mon amour ou de Si la brise, l’endiablé Tout, mais pas ça ! font partie des réussites du film (sans atteindre, pour autant la verve de A la mi-août, l’éclat de Tant je suis amoureux de vous ou le charme de J’ai peut-être tort du premier film)..
, ne sont pas du tout désagréables, et les mélodies de Oui, mon amour ou de Si la brise, l’endiablé Tout, mais pas ça ! font partie des réussites du film (sans atteindre, pour autant la verve de A la mi-août, l’éclat de Tant je suis amoureux de vous ou le charme de J’ai peut-être tort du premier film)..
 Ce qui manque, pour arriver à la cheville de Nous irons à Paris
Ce qui manque, pour arriver à la cheville de Nous irons à Paris , outre un scénario mieux structuré, c’est peut-être le rayonnement de Françoise Arnoul
, outre un scénario mieux structuré, c’est peut-être le rayonnement de Françoise Arnoul (même si Danielle Godet
(même si Danielle Godet , aux faux airs de Micheline Presle
, aux faux airs de Micheline Presle est aussi bien jolie, mais tellement moins piquante), peut-être la bride trop laissée sur le cou des insupportables, chacun dans leur genre, Henri Genès
est aussi bien jolie, mais tellement moins piquante), peut-être la bride trop laissée sur le cou des insupportables, chacun dans leur genre, Henri Genès et Philippe Lemaire
et Philippe Lemaire ; c’est qu’on n’a pas à faire une suite d’un petit film charmant, mais tout de même limité ; ça se laisse voir sans déplaisir et on peut même trouver Audrey Hepburn
; c’est qu’on n’a pas à faire une suite d’un petit film charmant, mais tout de même limité ; ça se laisse voir sans déplaisir et on peut même trouver Audrey Hepburn déjà bien jolie, mais ça n’est pas à recommander aux yeux exigeants.
déjà bien jolie, mais ça n’est pas à recommander aux yeux exigeants.
Enfin ! Ça donne davantage de plaisir qu’un Ingmar Bergman ; c’est déjà ça.
; c’est déjà ça.
