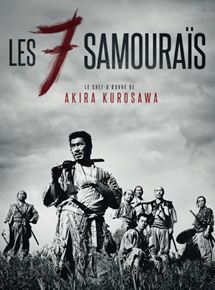 Fighting in the rain.
Fighting in the rain.
Je me dis de temps à autre qu’il n’est pas concevable que je puisse achever ma vie de cinéphage sans découvrir un des films mythiques dont on dit ici et là monts et merveilles, mais qui ne m’ont jamais attiré. Vieux sens catholique de la culpabilité, sans doute. Voilà que malgré mes réticences envers tout ce qui a trait au Japon (et à l’Asie en général) et au bénéfice de l’emprunt sur l’étagère d’une DVDthèque amie, voilà que je viens de regarder Les sept samouraïs. Une interminable version de 194 minutes (3 heures et quart !) alors qu’il existe des versions tronquées, sans doute moins conformes à la pensée du réalisateur, mais bien davantage praticables pour un cerveau occidental.
 Car c’est bien long, trois heures et davantage, pour un sujet aussi mince ! J’avais fait la même réflexion devant Les sept mercenaires de John Sturges, qui est un remake tout à fait avoué des Sept samouraïs et qui ne dure qu’un peu plus de deux heures. Pousserai-je l’iconoclastie jusqu’à dire que, finalement, dans ces histoires de combattants héroïques qui protègent un village des exactions de bandits farouches le meilleur me semble être la parodie Three amigos de John Landis qui ne dure que 98 minutes ? Je n’irai tout de même pas jusque là.
Car c’est bien long, trois heures et davantage, pour un sujet aussi mince ! J’avais fait la même réflexion devant Les sept mercenaires de John Sturges, qui est un remake tout à fait avoué des Sept samouraïs et qui ne dure qu’un peu plus de deux heures. Pousserai-je l’iconoclastie jusqu’à dire que, finalement, dans ces histoires de combattants héroïques qui protègent un village des exactions de bandits farouches le meilleur me semble être la parodie Three amigos de John Landis qui ne dure que 98 minutes ? Je n’irai tout de même pas jusque là.

Interminables, Les sept samouraïs sont aussi plastiquement très beaux, tout au moins lorsque Kurosawa ne filme pas trop les mimiques, grimaces et éructations des villageois ou des samouraïs qui rivalisent de comportements bizarres qui feraient assimiler notre Louis de Funès national à un modèle de sobriété janséniste. Toujours est-il que le cinéaste est doté d’un beau sens de l’image et que certains plans ont quelque chose qui fait songer aux merveilleuses compositions esthétiques d’Eisenstein. Qu’il sait également susciter des atmosphères puissantes, prenantes, impressionnantes comme celles de la fin du film qui se déroulent dans la boue et sous la pluie battante où s’affrontent d’un côté villageois et samouraïs, d’autre part malandrins.

Le malheur est qu’il faut attendre le début de la troisième heure de film pour que tout cela commence à bouger ; dans les deux premiers tiers, ça chipote et ratiocine autour du recrutement des mercenaires puis de leur installation dans le village. Et en deux heures ne pas parvenir à identifier, à caractériser les combattants, à ne pas leur donner chair et sang, c’est bien dommage ; dans tous les films de groupe – et Dieu sait s’il y en a ! – un des principaux intérêts est de poser des silhouettes, des personnages que tout pourrait opposer et qui seront finalement rassemblés dans un improbable et nécessaire combat commun et de donner à chacun une touche qui les attachera au spectateur, qui installera avec eux un lien d’empathie. Il est rare que les réalisateurs y parviennent absolument : ni dans Les douze salopards, ni dans La révolte des dieux rouges (je cite ce qui me vient à l’esprit) Robert Aldrich ou William Keighley ne parviennent totalement à donner à chaque physionomie une véritable identité.
 Mais dans Les sept samouraïs, qui peut se souvenir des combattants subalternes qui périssent au fil des séquences ? Leurs traces s’évaporent assez vite : on ne sait ni d’où ils viennent, ni qui ils sont. Et donc on se fiche complétement de leur sort. Ça n’empêche pas, en plus des belles images, l’utilisation d’une musique extrêmement bien adaptée au rythme et aux péripéties du film. Et pas davantage la qualité du jeu de la plupart des acteurs qui, il est vrai, évoluent dans un monde si différent du nôtre qu’on serait bien en peine de leur reprocher quoi que ce soit.
Mais dans Les sept samouraïs, qui peut se souvenir des combattants subalternes qui périssent au fil des séquences ? Leurs traces s’évaporent assez vite : on ne sait ni d’où ils viennent, ni qui ils sont. Et donc on se fiche complétement de leur sort. Ça n’empêche pas, en plus des belles images, l’utilisation d’une musique extrêmement bien adaptée au rythme et aux péripéties du film. Et pas davantage la qualité du jeu de la plupart des acteurs qui, il est vrai, évoluent dans un monde si différent du nôtre qu’on serait bien en peine de leur reprocher quoi que ce soit.
J’ai donc vu Les sept samouraïs. Mais tant à parler de films longs, avec une heure de plus devant mon écran, j’aurais tout de même pu regarder une nouvelle fois Autant en emporte le vent qui est d’une autre profondeur et d’une autre richesse.
 Au fait, dans l’édition DVD que j’ai regardée, le disque de bonus présentait une intervention du pontifiant Jean Douchet, sorte de pion ravi de lui-même qui assène de graves propos sur l’alternance, dans le film, de courbes, de lignes droites, de triangles, de verticales, de perpendiculaires et d’obliques (comme si le monde visible n’était pas composé de ça !). Ce bonhomme enkysté des théories des Cahiers du cinéma énonce gravement que Kurosawa présente un film de lutte de classes où se jouxtent les paysans exploités et les samouraïs représentants de la fortune, alors que ceux-ci apparaissent en fait comme des chevaliers de fortune à la triste figure, aristocrates sans le sou. Il est vrai que ce genre de distinction, le marxiste Douchet ne doit pas pouvoir la saisir.
Au fait, dans l’édition DVD que j’ai regardée, le disque de bonus présentait une intervention du pontifiant Jean Douchet, sorte de pion ravi de lui-même qui assène de graves propos sur l’alternance, dans le film, de courbes, de lignes droites, de triangles, de verticales, de perpendiculaires et d’obliques (comme si le monde visible n’était pas composé de ça !). Ce bonhomme enkysté des théories des Cahiers du cinéma énonce gravement que Kurosawa présente un film de lutte de classes où se jouxtent les paysans exploités et les samouraïs représentants de la fortune, alors que ceux-ci apparaissent en fait comme des chevaliers de fortune à la triste figure, aristocrates sans le sou. Il est vrai que ce genre de distinction, le marxiste Douchet ne doit pas pouvoir la saisir.